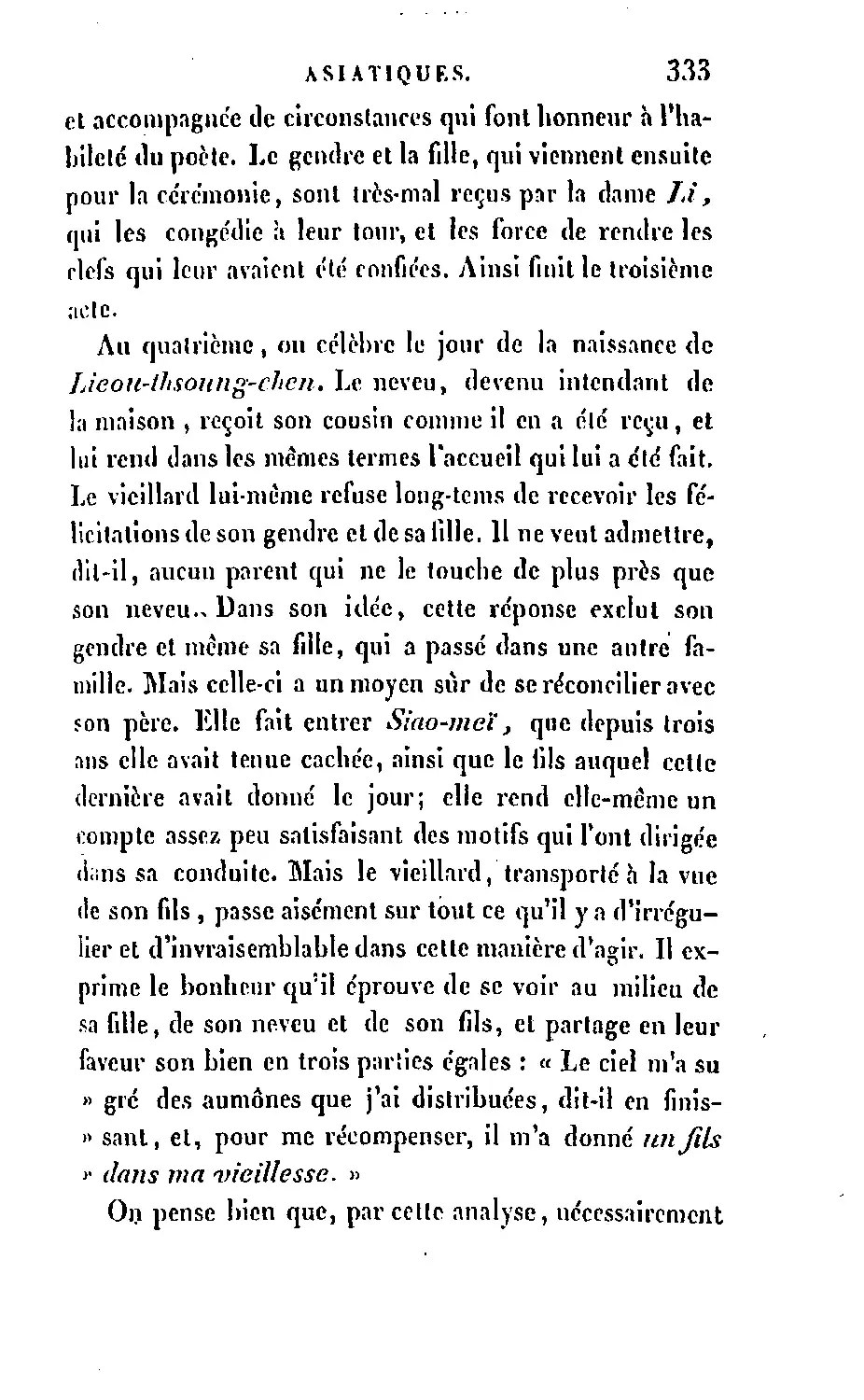Mélanges Asiatiques. 1
- Info
- Pages
- Transcript
- Related
SUR UNE COMÉDIE CHINOISE
INTITULÉE:
LE VIEILLARD QUI OBTIENT UN FILS.
Un écrivain célèbre du siècle dernier, admirateur passionné d’un art
auquel il devait ses plus grands succès et la plus belle partie de sa
gloire, cherchait à rehausser celle de la nation chinoise, en faisant
remarquer qu’elle cultivait, depuis plus de trois mille ans, cet art,
inventé un peu plus tard par les Grecs, de faire des portraits vivans
des actions des hommes, et d’établir des écoles de morale où l’on
enseigne la vertu en actions et en dialogues. Quand l’invention du poeme
dramatique à la Chine remonterait à une époque aussi reculée (ce qu’il
serait difficile de démontrer), il ne faudrait pas se hâter d’en tirer
un argument philosophique en faveur des Chinois. On a trouvé des
spectacles à Java, à Sumatra, et dans toutes les îles du grand Océan, où
la philosophie et mème la civilisation n’ont pas fait de grands progrès.
Si le théâtre a depuis longtems été institué à la Chine, il n’y a jamais
été en honneur; et, loin qu’on le considère comme une école de morale et
de vertu, on n’y voit qu’un amusement frivole et dangereux, contraire h
la gravité et à la décence, et pernicieux aux bonnes mœurs. Les lettrés
ont souvent déclamé contre les jeux des bateleurs et des comédien; car
la meme expression les désigne indifféremment. Mais ces déclamations
n’empêchent pas qu’il n’y ait partout des comédiens ambulans, qui vont
chez ceux qui les appellent, jouer des farces ou représenter des
tragédies; il est même du bel usage de les faire venir dans les repas de
cérémonie, pour divertir les convives, et ils sont admis jusque dans le
palais de l’empereur, où ils servent, concurremment avec les
marionnettes, les ombres mécaniques et les danseurs de corde, à
l’amusement de la cour et des ambassadeurs étrangers. C’est qu’à la
Chine on ne se fait nulle difficulté de se montrer peu conséquent à ses
principes, et qu’on y est, comme ailleurs, beaucoup plus sévère en
théorie qu’en pratique.
Néanmoins, comme il n’y a jamais eu de théâtre public dans l’empire, et
comme une telle institution est trop en opposition avec les lois, les
usages et les préjugés nationaux, pour pouvoir jamais s’y introduire, on
conçoit que l’art dramatique a dû souffrir du peu d’importance qu’on met
à ses productions. Ce n’est pas une simple tolérance, ou l’accueil
secret de quelques particuliers, qui peut faire naître des chefs-d’œuvre
en ce genre : il faut aux auteurs cl aux comédiens, des fêtes
solennelles, le concours d’un grand nombre de spectateurs, des éloges
publics, des applaudissemens universels. La police chinoise serait
renversée de fond en comble, si des histrions obtenaient ces
encouragemens. Les auteurs comiques se ressentent de la même influence ;
et si ceux qui jouent les pièces de théâtre sont assimilés aux
bateleurs, ceux qui les composent sont relégués, avec les romanciers et
les auteurs de poésies légères, dans la dernière classe de la
littérature. Quoi qu’en puisse dire un auteur anglais, dont nous allons
faire connaître le travail, les ouvrages de pur agrément sont comptés
pour peu de chose par les Chinois, dont l’estime avouée n’a d’autre
règle qu’une utilité directe et immédiate. Le P. Cibot a bien peint
leurs préjugés a cet égard, quand il a dit : “Les idées politiques de la
Chine sur la poésié ne sont pas les memes que celles de l’Europe...Le
mérite de faire de beaux vers attire peu l’attention du gouvernement. On
dit ici qu’un homme de lettres fait bien des vers, comme on dit en
France qu’un capitaine d’infanterie joue bien du violon.”
C’est comme un prodige que l’art dramatique , au milieu de tant de
causes qui devaient en arrêter les progrès, ou plutôt le retenir dans un
éternel état d’enfance, ait pourtant fait quelques pas vers la
perfection, et puisse même soutenir un instant de comparaison avec les
idées que nous nous en formons. Jusqu’à présent, on n’avait eu, pour en
juger, que l’Orphelin de la maison de Tchao, tragédie que le P. Prémare
a extraite d’un recueil de cent pièces de théâtre, et mise en français.
M. Davis vient de tirer du même recueil une comédie qu’il a traduite en
anglais : ainsi l’on peut, par ces deux échantillons, prendre une idée
du goût chinois dans les deux genres. Sur la première de ces deux
pièces, des juges éclairés dans ces matières avaient pensé que le
théâtre chinois pouvait être intéressant à étudier. Voltaire alla plus
loin, et voulut prouver qu’il pouvait être bon à imiter: dans ce
dessein, il choisit pour sujet d’une de ses tragédies , la fable même de
la pièce traduite par le père Prémare. A la vérité, il eut soin de
préparer et d’embellir toutes les situations qu’il y avait prises, d’en
faire disparaître toutes les irrégularités, d’en former enfin une pièce
nouvelle, pour ainsi dire, qui n’a presque de commun que le titre avec
son prétendu original. Il eût été difficile d’agir autrement; mais
aussi, il s’en faut bien que l’Orphelin de Tchao soit la meilleure et la
plus régulière du recueil où elle a été prise. Le drame nouveau[1] nous
paraît bien supérieur dans son genre, et bien moins éloigné de l’idée
que nous nous formons d’une bonne comédie, sous le rapport de la fable,
de la conduite et du style, que ne l’est, à tous ces égards, du modèle
d’une bonne tragédie, la pièce traduite par le P. Prémare.
Le traducteur, M. J. F. Davis, fils du directeur de la compagnie des
Indes à Canton, est un jeune littérateur déjà connu par la traduction
d’un petit roman intitulé San-iu-Leou, roman dont les journaux anglais
ont parlé avec beaucoup d’éloges. Sa nouvelle traduction justifie ces
éloges, et donne lieu d’espérer qu’elle sera suivie de quelques autres
ouvrages du même genre. L’auteur paraît vouloir profiter des progrès
qu’il a faits dans l’étude du chinois, pour transmettre à ses
compatriotes quelques-unes de ces productions légères des Chinois, que
les missionnaires et les autres savans ont peut-être trop négligées,
C’est là, sinon une des plus utiles, au moins une des plus agréables
applications de la connaissance des langues. On voit avec plaisir les
personnes qui se trouvent au milieu des naturels, entreprendre ces
sortes de travaux ; ils n’exigent pas ce genre de recherches auxquelles
il serait impossible de se livrerdans les contrées lointaines, où l’on
est privé (lu secours de nos bibliothèques; et ils demandent, au
contraire, par rapport aux expressions populaires, aux proverbes, aux
allusions, ces notions locales, auxquelles les connaissances les plus
profondes, acquises dans les livres, ne peuvent souvent suppléer
qu’imparfaitement.
La traduction de M. Davis est précédée d’un Coup-d’œil sur le drame
chinois, et sur les représentations théâtrales. On v a réuni, sur l’état
actuel de l’art théàtral à la Chine, quelques renseignement dont les
relations des voyageurs ont le plus souvent fourni la matière; j’en
extrairai quelques faits qui m’ont paru moins connus. La construction
des théâtres n’entraîne pas à de grands frais; c’est ordinairement la
troupe elle-même qui en construit un : en moins de deux heures, on a
planté des piliers de bambous, qui soutiennent, à six ou sept pieds de
terre, un toit fait avec des nattes : des pièces de toile peinte ferment
la scène de trois côtés, et les spectateurs se placent en face du
quatrième, qui reste ouvert. Rien n’indique le changement de scène : un
général reçoit l’ordre de se rendre dans un province éloignée; il monte
sur un bàton, fait claquer un fouet, ou prend à la main une bride, et
saute en faisant trois ou quatre fois le tour du théâtre, au bruit des
tambours et des trompettes; puis il s’arrête tout court, et apprend aux
spectateurs le nom du lieu où il est arrivé. Pour représenter une ville
prise d’assaut , trois ou quatre soldats se couchent l’un sur l’autre,
et figurent la muraille. Ces puérilités ne préviendront pas les bons
esprits contre le théâtre même. La pompe du spectacle n’a rien de commun
avec les véritables secrets de l’art, et les bons ouvrages sont ceux qui
peuvent le plus aisément s’en passer. L’auteur anglais avoue que la
scénique n’était pas beaucoup plus perfectionnée en Angleterre, il y a
deux siècles, et il remarque que la première invention des toiles
peintes pour les changemens de scène, est attribuée à Inigo Jones, qui
les imagina à Oxford en 1605.
On dit que, quand la cour réside a Peking, on compte dans cette capitale
plusieurs centaines de troupes, qui vont, dans d’autres tems, parcourir
les provinces. Chaque troupe est composée de huit ou dix personnes, qui
sont, à proprement parler, les domestiques ou les esclaves du maître.
Ils voyagent dans des barques couvertes, le long des canaux et des
rivières, sur le bord desquels sont situées la plupart des grandes
villes. Ces barques sont leur habitation, et c’est là que le maître les
exerce à la declamation, et leur apprend leurs rôles. Les personnages de
femmes sont représentés par des hommes, depuis l’époque où le feu
empereur Khian-loung prit pour seconde femme une actrice, en dépit du
réglement qui défend aux hommes en place de fréquenter les actrices et
les femmes de mauvaise vie. Il est interdit aux auteurs de mettre sur la
scène les empereurs, impératrices, princes, ministres et généraux des
tems anciens. Ainsi, le drame historique serait proscrit précisément
chez la nation qui devrait l’avoir le plus en honneur, et par un
gouvernement dont toutes les démarches sont, si j’ose ainsi parler, une
perpétuelle représentation des actions et des maximes anciennes. Mais,
suivant l’auteur anglais , cette défense est perpétuellement enfreinte;
ces sortes de représentations étant, en réalité , l’objet favori et
habituel de l’art dramatique. Voilà ce que j’ai remarqué de plus digne
d’attention dans les détails relatifs au régime théâtral des Chinois. Ce
qu’on lit ensuite sur les représentations, le jeu des acteurs, le sujet
ordinaire des pièces, est extrait, en grande partie, des relations
publiées par les différens voyageurs qui ont visite l’empire chinois, et
se trouve déjà dans plusieurs ouvrages fort répandus. Je finirai donc
l’extrait de ce discours en remarquant, d’après l’auteur, que les
représentations théâtrales sont, à la Chine, plus puériles et plus
insignifiantes, à proportion du rang élevé des spectateurs. A la cour et
devant les ambassadeurs, on donne la préférence aux jongleurs, aux
danseurs de corde, et même aux marionnettes, sur les meilleurs acteurs.
C’est ainsi que, sous la reine Anne, la bonne compagnie de Londres
courait aux puppetshows, et laissait au vulgaire le soin d’applaudir aux
tragédies de Shakespeare et d’Otway.
Dans un court avertissement, qui précède immédiatement sa traduction, M.
Davis remarque que les pièces chinoises sont, en grande partie,
composées de vers irréguliers, qui sont chantés en musique. “Le sens,”
dit-il, “en est souvent obscur ; et, suivant les Chinois eux-mêmes, on
s’attache principalment à flatter l’oreille, le sens lui-même paraissant
négligé ou sacrifié a l’harmonie.” Il avertit en même tems que , dans
les endroits douteux, il a demandé l’avis de deux ou de plusieurs
natifs, et qu’il a adopté ensuite le sens qui lui a paru plus conforme
au génie de la langue et au but de l’ouvrage; mais qu’un fort petit
nombre de passages, d’une indécence grossière et d'un ennui
insupportable, ont été, à dessein, supprimés dans sa traduction. Nous ne
pouvons qu’applaudir à l’un de ces deux procédés, mais nous ne saurions
approuver également l’autre. Quand on traduit un ouvrage d’une langue
savante, on peut sans doute le purger de tout ce qui choquerait la
décence et la pureté de nos langues d’Europe ; mais on n’est nullement
tenu de le rendreplus intéressant qu’il ne l’est en lui-même. Ces sortes
de traductions doivent avoir pour objet de faire connaître le goût et le
génie d’un peuple aux lecteurs instruits, et non d’amuser les lecteurs
frivoles, qui ne manquent point de sujets pour exercer leur curiosité,
et qui, d’un autre côté, ne seraient jamais satisfaits des sacrifices
qu’on ferait en leur faveur. M. Davis nous paraît d’ailleurs avoir usé
un peu trop pleinement du privilège qu’il s’est donné ; et quoiqu’il
prétende n’avoir supprimé qu’un très-petit nombre de passages, ses
omissions sont réellement assez considérables, et formeraient presque un
tiers de l’ouvrage. On ne peut croire que la difficulté de traduire ces
passages l’ait arrêté, puisqu’il n’y a point de difficultés pour un
traducteur aidé des naturels du pays. Par ces suppressions, il a
réellement rendu le drame plus rapide, et sa traduction plus conforme à
notre manière de voir; mais aussi il lui a fait perdre cette couleur
naturelle et ce goût chinois qu’il était essentiel de conserver.
On ne peut nier que le genre d’utilité le plus incontestable des drames
et des romans des nations lointaines, ne soit de faire juger les mœurs
cl les usages de ces nations, en les mettant en action, et en les
présentant sous un jour plus naïf et plus vrai qu’on ne le peut faire
dans une relation. Mais, d’un autre côté, la condition indispensable
pour juger du degré d’intérêt de ces productions, même, jusqu’à un
certain point, pour les entendre, ce serait la connaissance de ces mœurs
et de ces usages dont on y cherche l’esprit. Par exemple, dans la
comédie nouvellement traduite, tout l’intérêt se porte sur un vieillard
qui se voit près de mourir sans enfans màles; et, quoique ce soit en
tout pays un malheur que de ne pas laisser de postérité, on ne peut, à
moins d’être bien imbu des idées chinoises à cet égard, apprécier
convenablement l’importance que ce vieillard met à avoir un fils; le
désespoir qui l’accable, quand il se croit privé de cette consolation;
l’excès de sa joie, quand il apprend que le ciel la lui a enfin
accordée. Pour ne rien trouver d’exagéré dans tous ces sentimens, il
faut connaître et avoir bien présentes à l’esprit les relations que les
lois, la morale, j’oserais dire la religion, ont établies entre les
parens et les enfans, et qu’elles perpétuent après la mort des premiers,
par les devoirs qu'elles imposent aux autres. Il faut savoir qu’un
Chinois, près de mourir sans enfans males, envisage son sort du même œil
qu’un Européen qui se verrait, ici, privé des honneurs funèbres : il est
déshonoré, sa famille est éteinte , personne n’héritera de son nom, ses
files le perdront en passant dans la famille de leur mari ; on ne fera
point en son honneur ces cérémonies journalières qui, suivant l’idée de
Confucius, rendent les morts toujours présens au milieu des vivans; on
ne viendra point, matin et soir, se prosterner devant la tablette où son
nom sera inscrit ; on ne brûlera point des parfums, on ne lui offrira
pas des mets, on n’arrangera pas ses habits, on ne tiendra pas sa place
vacante au milieu de sa famille, comme cela est recommandé dans le
Tchoung-young ; on ne remuera pas la terre sur sa sépulture, on ne
cultivera pas les arbres qui y seraient plantés ; au jour anniversaire
de sa mort, on ne viendra pas pleurer et se lamenter sur son tombeau.
Voilà les calamités que redoute celui qui ne laisse point de fils après
lui; voilà les préjugés que la philosophie chinoise a renforcés de tout
son pouvoir, loin de chercher à les détruire. Il nous faut un
commentaire pour nous mettre en état de les concevoir; mais toutes ces
idées se réveillent en Chine, au seul titre de la pièce que nous avons
sous les yeux : Lao seng eul, le Vieillard à qui il naît un fils[2]. Ce
ne serait chez nous qu’un bonheur ordinaire : c’est, à la Chine, un coup
du ciel. Le principal personnage est sauvé d’un malheur accablant : les
traverses qui vont lui faire craindre d’y retomber, exciteront au plus
haut degré l’intérêt et la compassion des spectateurs.
Un vieillard de Toung-phing-fou nommé Lieou-thsoung-chen, a ramassé une
grande fortune dans le commerce; sa conscience lui reproche les moyens
dont il s’est servi pour l’acquérir; le ciel l’en punit cruellement; il
a soixante ans; sa femme, Li, en a cinquante-huit; il n’a qu’une fille
qui est mariée, et un neveu, fils de son frère, qui porte le meme nom de
famille que lui; mais tout le monde dans sa maison est conjuré contre ce
neveu : sa femme, sa fille et surtout son gendre. On craint que le
vieillard ne veuille laisser son bien à cet héritier du nom de sa
famille. La femme oblige son mari à le chasser de chez lui ; le gendre,
chargé de compter à son cousin une somme d’argent, lui en vole une
partie; le pauvre neveu est renvoyé sans pitié. Le vieillard, a la
sollicitation de sa femme, remet toutes ses clefs à son gendre, et lui
abandonne la direction de son bien. Tout le monde est content, excepté
le neveu, qui se trouve réduit à la misère. Le vieillard, prêt a partir
pour la campagne, annonce à sa femme la grossesse de Siao-meï, sa
seconde femme, lui recommande d’avoir beaucoup de ménagemens pour elle,
et demande avec instance d’être informé tout de suite du sexe de
l’enfant qu’elle lui donnera. Telle est la matière du Sie-tseu ou
prologue : la marche en est rapide, le dialogue naïf et animé. La
passion de la dame Li contre son neveu, le caractère intéressé et
sordide du gendre, la joie de Lieou-thsoung-chen en parlant d’avance du
fils qui doit lui naître, l’impatience de sa femme, qui ne partage point
cette joie, tout cela est peint avec chaleur, et assaisonné de traits
vifs et comiques.
Au premier acte, le gendre déplore son malheur de se voir privé de
l’héritage sur lequel il avait compté. “Jamais, dit-il à sa femme, je ne
vous aurais épousée , si j’avais pu m’attendre à ce qui m’arrive. Si
Siao-meï donne le jour à une fille, il faudra céder la moitié du bien de
votre père, et si c’est un fils, il faudra le céder tout entier.” La
jeune femme le console ; elle lui propose de feindre que Siao-meï a pris
la fuite avec un autre homme: cette feinte est adoptée; on en fait part
à la dame Li, et tous trois vont à la campagne trouver
Lieou-thsoung-chen. Celui-ci refuse d’abord d'ajouter foi à son malheur,
il croit qu’on lui prépare une surprise ; mais quand il est enfin
persuadé, il se livre à son désespoir, et prend la résolution de
distribuer des aumònes pour apaiser le ciel, dont la colère le poursuit.
Ainsi finit le premier acte, que le traducteur a beaucoup abrégé. On
voit que la scène, d’abord dans la maison de ville de
Lieou-tchsoung-chen, est transportée ensuite à la campagne. L’unité de
lieu n’est pas une règle qu'il faille s’attendre à trouver observée à la
Chine.
Le second acte commence par la distribution des aumônes, que le gendre
du vieillard est chargé de faire dans le temple de Khaï-youan. Une scène
de mendians placée en cet endroit, est égayée par quelques tours de
fourberie dont ces sortes de gens ont coutume d’user. Le neveu de
Lieou-thsoung-chen vient ensuite pour avoir sa part de la distribution;
il est repoussé durement par le gendre, accueilli avec tendresse par son
oncle, mais chassé de nouveau sur les instances de sa tante. Le
vieillard le congédie, en lui recommandant d’être exact à remplir ses
devoirs sur les tombeaux de ses ancêtres. Cette recommandation, prise
dans le sentiment même qui anime Lieou-thsoung-chen, fonde assez
adroitement la grande scène du troisième acte.
Dans celui-ci la scène est au milieu des tombeaux. La fille de
Lieou-thsoung-chen voudrait aller pratiquer les cérémonies accoutumées
sur ceux de sa famille ; mais son mari l’en éloigne pour la conduire à
la sépulture de la sienne. Cette manière de mettre en action les devoirs
qui séparent une fille de ses parens, me semble assez ingénieuse. Le
neveu vient ensuite, et, dans un monologue tout-à-fait touchant, il
exprime ses sentimens aux ombres de ses ancêtres, et témoigne le regret
de ne pouvoir, à cause de la pauvreté où il est réduit, orner leurs
tombes suivant son désir. Quand il est éloigné, Lieou-thsoung-chen et sa
femme arrivent à leur tour. Us savent que leur fille et leur gendre sont
partis avant eux, avec les gâteaux, les victimes et le vin chaud
destinés aux offrandes : mais tout cela a été porté aux tombeaux de la
famille de leur gendre. La faible offrande de leur neveu n’est point
aperçue. Lieou-thsoung-cheu déplore l’abandon où sont les sépultures, et
cette image redouble sa douleur, en lui présageant le sort qui attend sa
tombe et celle de sa femme. Celle-ci s’attendrit peu à peu, elle sent
l’isolement où se trouve une famille qui n’a point de rejetons màles
pour lui rendre les honneurs funèbres, et le résultat de cette scène,
qui est très-bien filée, fort intéressante, et écrite d’un style
très-propre au sujet, est que la dame Li accueille avec joie son neveu
qui revient pour achever les rites qu’il avait commencés. Cette
réconciliation est amenée avec beaucoup d’adresse, et accompagnée de
circonstances qui font honneur à l’habileté du poète. Le gendre et la
fille, qui viennent ensuite pour la ceremonie, sont très-mal reçus par
la dame Li, qui les congédie a leur tour, et les force de rendre les
clefs qui leur avaient été confiées. Ainsi finit le troisième acte.
Au quatrième, on célèbre le jour de la naissance de Lieou-thsoung-chen.
Le neveu, devenu intendant de la maison, reçoit son cousin comme il en a
été reçu, et lui rend dans les mêmes termes l'accueil qui lui a été
fait. Le vieillard lui-mème refuse long-tems de recevoir les
félicitations de son gendre et de sa fille. Il ne veut admettre, dit-il,
aucun parent qui ne le touche de plus près que son neveu. Dans son idée,
cette réponse exclut son gendre et même sa fille, qui a passé dans une
autre famille. Mais celle-ci a un moyen sur de se réconcilier avec son
père. Elle fait entrer Siao-meï que depuis trois ans elle avait tenue
cachée, ainsi que le fils auquel cette dernière avait donné le jour;
elle rend elle-même un compte assez peu satisfaisant des motifs qui font
dirigée dans sa conduite. Mais le vieillard, transporté à la vue de son
fils , passe aisément sur tout ce qu’il y a d’irrégulier et
d’invraisemblable dans cette manière d’agir. Il exprime le bonheur qu’il
éprouve de se voir au milieu de sa fille, de son neveu et de son fils,
et partage en leur faveur son bien en trois parties égales : “Le ciel
m’a su gré des aumônes que j’ai distribuées, dit-il en finissant, et,
pour me récompenser, il m’a donné un fils dans ma vieillesse.”
On pense bien que, parcelle analyse, nécessairement aride et décharnée,
je n’ai pas espéré faire partager l'intérèt que ce drame m’a inspiré à
la lecture, mais il m’a semblé que c’était le moyen le plus court et le
plus sûr de faire juger la conduite d’une pièce chinoise. La durée de
celle-ci est, comme on voit, de trois années au moins : le lieu de la
scène y change plusieurs fois. Mais des irrégularités si légères,
qu’elles seraient à peine remarquées chez nos voisins, ne sauraient
contrebalancer le mérite de cette pièce, qui se distingue par la
simplicité du plan, le choix heureux des incidens, l’observation exacte
des caractères, quelques situations comiques, et par un style naturel et
simple dans la prose, noble et élevé dans la mélopée.
La traduction de M. Davis, quoique incomplète, est en général conforme
au texte, et peut même en rendre l'intelligence facile aux commençans.
En la publiant, on a donc rendu un véritable service aux amis de la
littérature asiatique[3].
[1] Laou-seng-urh, or, “an heir in his old age” a chinese drama. London,
1817, in-16 de xlix et ii5 pages. Suivant l'orthographe dont les
missionnaires de toutes les nations nous ont fourni les bases, et dont
les transcriptions faites à la Chine par les Mandchous constatent
l'exactitude , il faut lire Lao seng eul. La nouvelle orthographe
adoptée par les auteurs anglais, ne peut convenir qu’aux lecteurs de
cette nation, et rend pour tout autre les mots chinois entièrement
méconnaissables. Ces trois mots signifient, le vieillard qui obtient un
fils, sens que la phrase du titre anglais n'exprime pas avec assez de
clarté.
[2] Le traducteur anglais a rendu ces mots par an heir in his old age.
Par là il a conserve la tournure amphibologique de la phrase chinoise.
[3] Feu M. Bruguière Je Sorsum, auquel on devait déjà une version
française du beau drame indien de Sacontala, a fait passer en français
la comédie chinoise traduite par M. Davis (Paris, chez Rey et Gravier,
1819, in-8°); et il avoue que la lecture de l'analyse qu’on vient de
lire, insérée en 1818 dans le Journal des Savans, l’avait décidé à
entreprendre ce travail en lui donnant une garantie pour l’exactitude de
celui de M. Davis. Cet estimable littérateur qu’une mort prématurée a
enlevé aux lettres et à ses amis , a laissé une traduction du drame
samskrit allégorique, intitulé : le Lever de la Lune de l'Intelligence.
Cette traduction sera publiée incessamment, et celui qu’on a chargé d’en
surveiller la publication, s’acquittera de cette tâche honorable avec le
soin et l’exactitude que lui imposent ses regrets et sa vénération pour
la mémoire d’un ami.